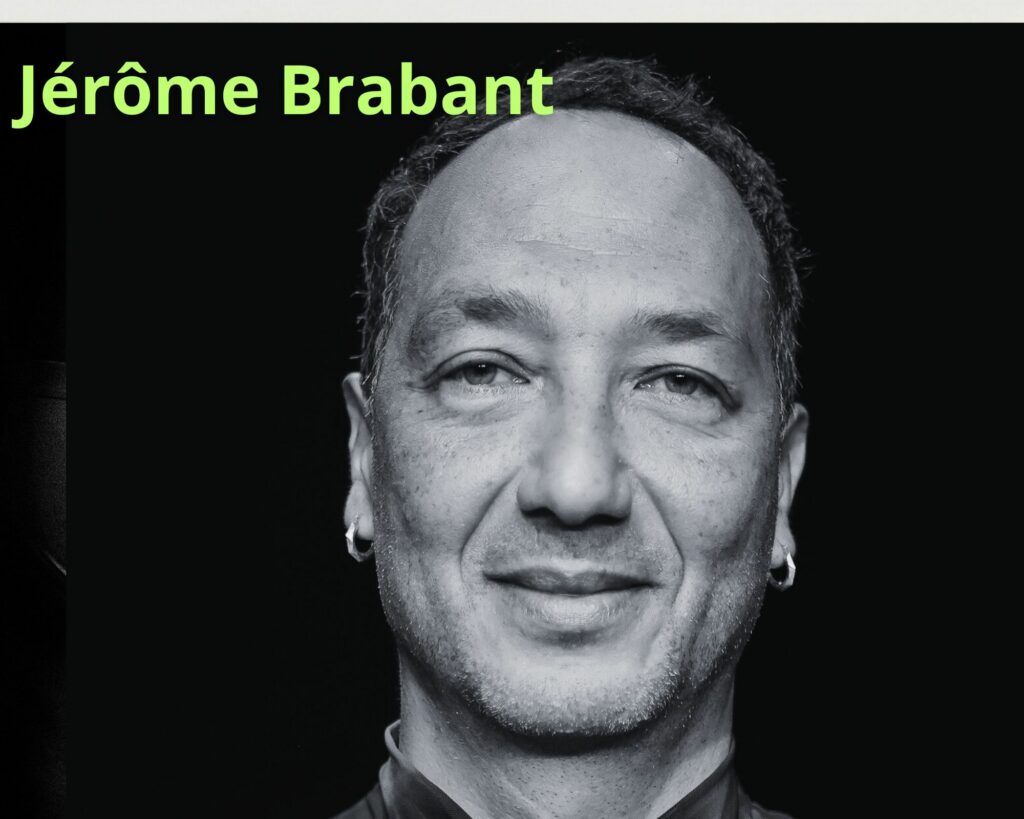
Qu’est-ce qui relie une installation d’art contemporain, des sphères céramiques déclenchant des sons, et une pièce chorégraphique explorant le système solaire ? Rencontre avec la chorégraphe qui, après avoir découvert Disharmony of Spheres des artistes Foo/skou, a transformé l’expérience sensorielle en une danse des planètes, mêlant données astronomiques, symbolique mythologique et collaboration musicale. Entre ordre et chaos, matière et mouvement, Planètes interroge notre place dans l’univers et la fragilité du vivant.
Vous avez imaginé Planètes après avoir découvert l’installation Disharmony of Spheres des artistes Foo/skou au Danemark. Qu’est-ce qui, dans cette œuvre plastique et sonore, a déclenché votre envie de créer cette pièce chorégraphique ?
C’est une installation composée de sphères en céramique, chacune posée sur un socle, qui formaient autant de planètes alignées dans l’espace. En circulant parmi ces sculptures, le spectateur déclenchait des sons grâce à des capteurs installés au-dessus de chaque « planète ». Ces sons avaient été enregistrés par le duo Philip I Schneider, qui est aujourd’hui au cœur de ma pièce.
J’ai immédiatement perçu un écho avec mon propre travail : l’idée d’un voyage dans le système solaire, d’une exploration d’ailleurs qui déplace la conscience et brouille la notion du temps. J’ai ensuite collaboré avec le duo, présent lors de la clôture de l’exposition où elles avaient chanté avec quelques artistes de leur collectif, formant un chœur. C’était comme une mise en abyme chantée de l’installation. La musique, le chant, l’écoute sont toujours essentiels dans mes créations. Planètes est née de cette rencontre. En voyant l’installation, j’ai tout de suite imaginé de la danse et eu envie d’en proposer ma propre version. Ce qui m’a particulièrement intéressé, c’est le principe d’un son déclenché par le mouvement, d’une partition aléatoire, que Nicolas Martz, le créateur sonore, a reproduit par la spacialisation du son.
Chaque interprète incarne une planète. Comment avez-vous transposé le mouvement des astres et leur symbolique dans l’écriture du geste chorégraphique ?
J’ai mené beaucoup de recherches scientifiques pour cette pièce. Ma danse s’inspire souvent de données anthropologiques ; ici, il s’agissait de données astronomiques. J’ai fait une résidence au Planétarium de Reims, regardé de nombreux films, échangé avec les médiateurs et le directeur. Cette résidence a donné lieu à une conférence dansée qui relie création chorégraphique et connaissances scientifiques.
J’ai sélectionné pour chaque planète les caractéristiques les plus pertinentes pour les transformer en geste : couleurs, symbolique, données géologiques ou météorologiques… Par exemple, Mars est rouge, traversée de tempêtes, marquée par des traces d’eau ; c’est le dieu de la guerre, associé à la lance et au bouclier. Tout cela nourrit le mouvement.
J’écris des phrases chorégraphiques sur mesure. En travaillant auprès de la chorégraphe Mié Coquempot, j’ai appris à décliner une phrase initiale selon les procédés de la danse contemporaine. J’ai ensuite attribué les planètes aux interprètes : certains en incarnent deux. Leur corporéité m’a guidée : Alexandra Damasse et Nina Vallon portent Vénus par leur gestuelle, Yves Mwamba — grand et puissant — est Mars, Valentin Mériot et Lucie Vaugeois incarnent Mercure, dieu du commerce et des messagers. Manuèle Robert, 68 ans dans Saturne et ses anneaux. Une danse faite de cercles, de volumes sphériques ponctuée d’éclats, de désarticulation, comme des explosions de folie. Autant de diversité au plateau en écho à la diversité qui existe dans notre système solaire. Je pense toujours aux corps concrets des interprètes en écrivant. Puis ils ont adapté et approprié les chemins que je leur proposais.
La musique du duo danois Philip I Schneider occupe une place centrale. Comment s’est construite la relation entre danse et chant ?
J’ai d’abord écrit la danse. Lors de notre première résidence de trois jours, nous avons simplement appris à nous connaître. Je leur ai montré le travail chorégraphique, et Joséphine Philip et Hannah Schneider ont composé le chant à partir de cela. Je leur ai donné quelques indications, comme je l’ai fait avec Françoise Michel la créatrice lumière. Elles ont aussi travaillé à partir de vidéos des résidences ou directement en studio lorsqu’elles étaient présentes.
Tout s’est aligné très vite — comme les planètes, justement. Nous nous comprenions presque sans parler. Mes pièces naissent toujours de rencontres, d’intuitions très fortes. Je sens immédiatement si cela va fonctionner. J’ai besoin d’une communication simple et d’une écriture fluide.
Dans vos précédentes créations, vous explorez la relation de l’homme au vivant. Comment ce thème se renouvelle-t-il ici à travers le prisme du cosmos ?
Je me renouvelle, et en même temps je reste fidèle à mes obsessions. Planètes se situe toutefois ailleurs. La pièce interroge la place du vivant dans l’univers, et surtout la disparition possible de l’être humain du système solaire. Que se passe-t-il après la vie ? Ce n’est pas une question mystique : je m’interroge sur la survivance des cellules, sur la transformation des formes de vie, sur la possibilité de devenir d’autres entités.
Un autre fil s’est précisé : quel est le rôle de l’artiste ? J’aimerais que le public prenne conscience de sa place dans l’immensité de l’espace, de la fragilité de sa condition. Dans Heimat ou Impair, je questionnais un pays, une société. Ici, le point de vue devient interstellaire.
Vous parlez des corps comme de matières — pierre, glace, gaz, feu. Comment cela a-t-il nourri l’interprétation et l’écriture chorégraphique ?
Par les mots, d’abord. Si j’ai choisi ces interprètes, c’est parce que je connais leur capacité à s’emparer de ma danse. Nous partageons un terrain commun, parfois inconscient. Mais j’ai aussi voulu les nourrir : je leur ai montré des œuvres d’Anna-Eva Bergman, des vidéos de Foo/skou, nous avons écouté des musiques, je leur ai parlé longuement de ce que représente pour moi l’île de La Réunion.
Je voulais qu’ils dansent la matière spécifique de chaque planète. Nous sommes des danseurs : nos corps, nos personnalités s’effacent parfois pour devenir autre chose — ici, de la matière en transformation. C’est une continuité de mon travail. Dans Heimat, nous étions du sable, un coquillage, une montagne ou un volcan. Ici encore, nous sommes volcans, terre, glace. Ce graphisme traverse toute mon œuvre.

La pièce semble osciller entre ordre et chaos, répétition et transformation — à l’image des mouvements planétaires. Comment avez-vous traduit cette tension ?
Planètes comporte effectivement des moments chaotiques. J’obtiens ce chaos en demandant aux interprètes de réinterpréter la phrase initiale sur 8 ou 16 temps, puis je place cette matière dans l’espace. Ce sont des chaos très structurés. Comment créer un chaos scénique qui ne s’éparpille pas ? Nous avons essayé l’improvisation libre, mais ce n’était pas concluant. Il a fallu trouver un chemin chorégraphique précis, des rendez-vous qui donnent des repères aux interprètes — comme des orbites.
Vous proposez aussi une conférence dansée en lien avec la pièce. Comment ce format prolonge-t-il votre démarche ?
Cette conférence est un outil de médiation qui prolonge l’expérience du spectacle. Elle est adaptée aux lieux non dédiés à la danse. La première a eu lieu au Planétarium de Reims, ce qui prenait tout son sens. En 2026–2027, nous tournerons dans des collèges : cette conférence permettra d’ouvrir le dialogue avec les élèves sur le système solaire, notre place dans l’univers, notre finitude.
L’idée est de donner envie de s’intéresser à la fois à la science, au spectacle vivant et aux liens entre disciplines. C’est aussi une manière de partager une vision du travail d’une compagnie.
Face aux déséquilibres du monde, Planètes évoque la quête d’un nouvel équilibre entre l’humain et la nature. Quel message ou quelle émotion souhaitez-vous transmettre ?
Je pense souvent à La Réunion, où les peuples vivent ensemble dans une forme d’équilibre précieux : Malbars, Chinois, Cafres, Zoreilles… J’ai envie d’alerter sur la destruction en cours de notre monde. Nous ne sommes pas éternels, et nous ne saurons probablement pas nous adapter au dérèglement que nous provoquons. Certaines plantes, certains animaux y parviendront ; l’humain, peut-être pas. Nous sommes une espèce en voie d’extinction. Aussi, il nous faut urgemment prendre soin les uns des autres et de notre environnement ; la bienveillance est indispensable.
La pièce parle aussi de finitude et de deuil, de ce que nous laissons derrière nous. J’ai perdu mon conjoint en 2016, puis Mié en 2019. Ces pertes m’ont profondément marqué et m’ont amené à repenser ma manière d’être au monde, de travailler, de consommer, de créer. Changer de paradigme est difficile, mais nécessaire.
Je réfléchis beaucoup à la manière de travailler de façon plus responsable, notamment sur le plan écologique. Je voyage beaucoup en avion : je serai bientôt à La Réunion pour le festival Souffle o.I#6 organisé par Lalanbik CDCN Océan Indien, mes chanteuses viennent du Danemark… Ces déplacements polluent. Avec les organisateurs, j’essaie de construire des tournées plus raisonnées. Avec Jonathan Boyer, directeur du bureau de production et diffusion Les Yeux dans les mots, nous préparons une tournée en Normandie en nous appuyant sur la constellation des théâtres du territoire, et en travaillant aussi sur les déplacements du public.
Propos recueillis par Cédric Chaory / Portrait : © Sophie Mourat / Planètes : © Vincent VDH
