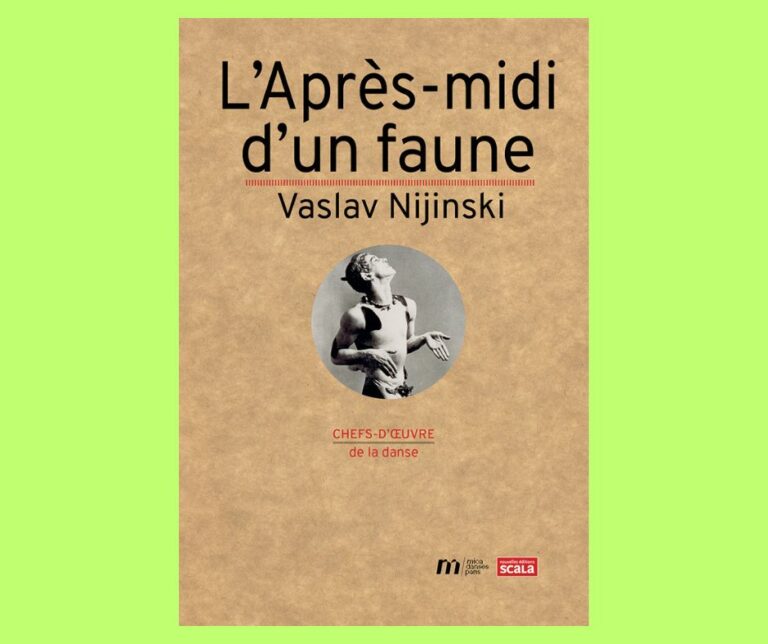
Le Faune et ses cent vies (au moins)
On en est au huitième volume de la collection « Chefs-d’œuvre de la danse » chez Scala, ce qui veut dire deux choses : Un: c’est une série qui commence à tenir debout toute seule. Deux: il n’y a pas grand-chose d’autre à se mettre sous la dent dans ce désert éditorial qu’est l’édition chorégraphique.
Cette fois, c’est L’Après-midi d’un Faune de Vaslav Nijinski qui passe à la moulinette — ou plutôt à la chirurgie esthétique savante, sous la plume de Philippe Verrièle. Après avoir autopsié Errand into the Maze de Martha Graham, Blue Lady de Carolyn Carlson, May B de Maguy Marin ou So Schnell de Dominique Bagouet, voilà qu’on remonte plus haut, plus tôt, plus mythique.
À dire vrai, L’Après-midi d’un faune est de ces œuvres dont tout le monde salue la grandeur avec la ferveur un peu gênée qu’on réserve aux monuments historiques qu’on n’a jamais vraiment visités. C’est vieux, c’est sacré, et il ne faut surtout pas poser de questions.
1912. Nijinski, créature moins mythologique que franchement hormonale, grimpe sur scène vêtu d’un collant couleur peau et, devant une salle bourgeoise, ose une chose impardonnable : il mime une masturbation contre un voile soyeux, tombé du corps d’une nymphe évanouie. Le public, habitué à voir ses ballets filtrés par une bonne dose de dentelle victorienne, manque la crise collective. On crie au scandale, au vice, à la pornographie — et on achète les billets deux fois plus cher le lendemain.
Dans cet affront au bon goût, Nijinski ne fait pas que scandaliser : il invente une nouvelle façon de danser. Mouvements plats, anguleux, archaïques. Rien du froufrou romantique ou de la grâce céleste. Juste un désir maladroit, grotesque et inéluctable. Claude Debussy, dont la musique sert de tapis volant à cette entreprise subversive, enrage un peu — puis se tait, grand prince fatigué qu’il était.
Depuis, les faunes pullulent. Plus ou moins heureux, plus ou moins ridicules. Dans les années 50, on astique l’œuvre à coup de puritanisme pour la faire briller sous les dorures de l’Académie. Dans les années 70, des faunes chevelus et sous acide prennent la scène d’assaut, la braguette ouverte sur l’éternité cosmique. Rudolf Noureev, jamais en retard d’un excès, campe un faune explosif, moitié dieu, moitié mauvais garçon du Saturday night. Jorge Donn, lui, danse la mélancolie pure : un faune qui sait que l’érotisme n’est qu’un prélude au néant.
Chacune de ces versions plaque sur la vieille bête son époque et ses névroses. Tantôt vicieux, tantôt pudique, tantôt grotesquement politisé. Aujourd’hui, le Faune est devenu une sorte de mascotte molle pour critiques fatigués, ressassant l’éternelle question : « Est-ce encore subversif si tout le monde applaudit à la fin ? ».
La grande ironie, c’est que ce ballet né d’un coup de reins maladroit est aujourd’hui disséqué avec tout le sérieux d’un colloque universitaire. Des générations de danseurs en collants sobres essaient de retrouver ce frisson primitif : celui d’un homme frottant son désir contre un chiffon et faisant hurler Paris.
Le volume des éditions Scala emballe tout cela dans une élégante boîte. Philippe Verrièle signe la mise en contexte, tandis qu’on retrouve la verve délicieusement grincheuse de Henri Bidou (tirée du Journal des Débats, avril 1912), cet honorable chroniqueur qui avait trouvé le Faune aussi scandaleux qu’une baignade mixte en pleine messe.
Thierry Malandain, chorégraphe malin et subtil, prend ensuite la plume. Lui qui, en 2000, osa recréer son propre Faune : un être seul, à moitié nu, sculpté dans l’ombre et la lumière. Fini les acrobaties sexuelles. Ici, le désir n’est plus montré, il est soupçonné. D’immenses mouchoirs évocateurs nous donnent quelques indices sur les activités passées ou à venir de la créature. Le Faune devient une créature blessée, caressée par le regret plus que par l’extase. On clôt ce tour de piste par une interview de Charles Jude, inoubliable interprète du Faune, interrogé par Bérengère Alfort. Jude, fidèle à lui-même, convoque une sensualité incandescente et sage à la fois — preuve que certains faunes ne vieillissent pas, ils mûrissent.
En 90 pages vives, le lecteur redécouvre pourquoi ce foutu Faune refuse de mourir. Pourquoi il hante encore les chorégraphes comme un vieux démon lubrique qui refuse de se taire.
À la dernière page, on se surprend à vouloir revoir un Faune — n’importe lequel : celui de Noureev, Robbins, LeDuc, Chouinard, Teshigawara, Gillis, Martin Kravitz, Olivier Dubois. Ou même s’en créer un nouveau, tout seul, dans son salon, en se frottant maladroitement à ses propres illusions. Après tout, il existe plus de 120 versions de ce ballet. Autant dire : autant de faunes que de raisons de continuer à désirer.
Cédric Chaory
L’Après-midi d’un faune de Vaslav Nijinski – Nouvelles éditions Scala
Martin
