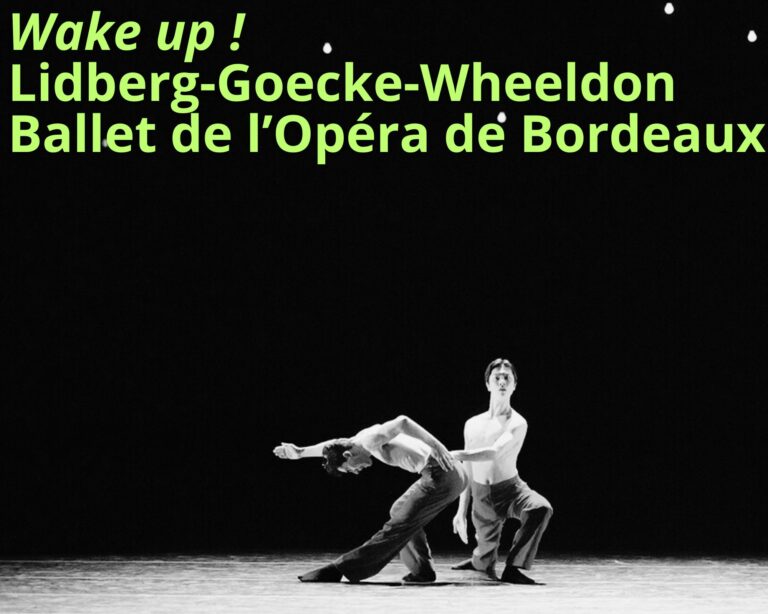
Bordeaux en éveil : un ballet qui secoue
On le sait. Depuis belle lurette, Bordeaux n’est plus endormie — et son ballet encore moins. Il serait naïf de croire que Wake up! n’est qu’un titre malin : il fonctionne ici comme un avertissement, voire comme un ordre implicite adressé à un public trop longtemps habitué à la douceur feutrée d’une scène tranquille. Du miroitement subtil de Lidberg aux secousses électriques de Goecke, jusqu’à la clarté policée de Wheeldon, la soirée confirme que la troupe bordelaise ne se contente plus de suivre la musique : elle frappe, elle titille, elle impose qu’on la regarde, et qu’on se réveille avec elle, à défaut de quoi l’on risque de rester à la traîne, spectateur paresseux.
The Shimmering Asphalt — Pontus Lidberg
Créé pour le New York City Ballet et ici repris dans une version bordelaise élargie à quinze interprètes, The Shimmering Asphalt s’épanouit comme un rêve suspendu — boulevard mouillé, souvenir, peut-être rêve, peut-être les deux. Lidberg, Suédois au regard cinématographique, conserve cette atmosphère fragile et pénétrante. Les corps glissent, s’effleurent, se dispersent comme des ombres sur un asphalte encore humide d’un temps qu’on devine à peine.
La lumière en clair-obscur de Mark Stanley cisèle les silhouettes ; le spectateur croit entendre le soupir d’un bitume sous projecteur, le frémissement silencieux d’un cristal brisé. Les costumes gris de Rachel Quarmby-Spadaccini, la scénographie ténue, la musique de David Lang : tout concourt à cette monochromie raffinée, presque argentée. Ce gris dense n’est jamais oppressant ; il devient une surface réfléchissante, une nuance subtile qui traduit un monde suspendu entre perception et mémoire.
Le ballet est davantage affaire de textures que de contrastes incisifs. La compagnie bordelaise, riche de tempéraments variés, s’y fond dans un collectif fluide : mouvements legato, transitions d’un tableau à l’autre d’une douceur presque morphique. Il y a une pureté de geste rare, un geste pour lui-même, précis, intérieur, dépouillé. Mais cette retenue porte en elle une limite : l’œil cherche une progression, une fracture dramatique. Or The Shimmering Asphalt n’en offre pas. Il berce, il promène, il fascine, mais il ne frappe pas.
Lang compose dans le minimalisme lyrique : nappes longues, élans retenus, harmonie silencieuse. Cette neutralité, au fond, est autant une vertu qu’un piège : elle adoucit le désir du spectateur, le pousse à souhaiter une irruption, une rupture, un cri. Mais la pièce refuse le sensationnel ; elle demeure dans l’état d’être, dans l’instant suspendu.
Lidberg aime la scène comme un cadre, comme un cinéaste sculpte ses plans. On sent l’œil du réalisateur : avant-plan, arrière-plan, profondeur, mouvements d’ensemble. Les corps semblent dotés d’un montage implicite ; chaque tableau glisse dans le suivant avec la souplesse d’un travelling intérieur. Dans cette reprise, c’est cette architecture invisible qui impressionne le plus.
Parmi les forces bordelaises : la précision de l’ensemble, la sensualité discrète du corps de ballet, et surtout la présence magnétique de Perle Vilette de Callenstein, dont le solo, sans éclat ostentatoire, concentre la lumière et suspend le temps. C’est là que la poésie prend corps, dans le détail et la patience de l’observation.
Woke Up Blind — Marco Goecke
Si The Shimmering Asphalt est un rêve suspendu, Woke Up Blind est un ouragan intérieur. À première vue, on pourrait la ranger parmi ces pièces « spectaculaires » de la scène contemporaine européenne, où spasmes, torsions et impulsions nerveuses dominent, sur les envolées de Jeff Buckley. Mais Goecke ne se contente pas d’accompagner la musique : il la défie, la soumet à son chaos personnel, la transforme en matière brute et vive.
Les danseurs bordelais s’y donnent corps et âme. Chaque geste vibre d’une tension presque animale, chaque silence semble prêt à exploser. Les duos ne caressent pas, ils frappent ; la proximité devient menace, l’étreinte fracture. Et pourtant, derrière ce chaos apparent, une vérité transparaît : l’impossibilité de se taire, le vertige exprimé sans détour ni masque. Tanguy Trévinal se révèle impérial : énergie féline, précision de l’ombre, intensité retenue. Chaque geste parle d’un combat intérieur. Dans une distribution qui oscille entre violence et grâce, il impose une clarté rare, offrant au spectateur, au milieu de la déflagration, un point d’ancrage.
Ne nous y trompons pas : Woke Up Blind fut incontestablement le meilleur programme de la soirée. Non pour sa virtuosité — encore qu’elle soit éclatante — mais parce qu’elle ose, parce qu’elle se risque là où la danse trop policée refuse de s’aventurer. Chez Goecke, l’impulsion, la colère et le génie naissent d’un même foyer ; sa danse est une déflagration qui ne détruit rien, mais révèle tout. En quinze minutes, l’orage passe, bref, furieux ; et pourtant, après lui, tout paraît plus net. On en sort secoué, éveillé, presque reconnaissant d’avoir été emporté par cette beauté en crise.
Within the Golden Hour — Christopher Wheeldon
Et voici la pièce de clôture, signée Christopher Wheeldon. Après l’urgence et la déchirure de Woke Up Blind, Within the Golden Hour apparaît d’abord comme un retour au calme, à l’élégance classique, à la courbe maîtrisée. C’est une danse de surfaces radieuses : la lumière (sublime … on croirait du Rothko), la musique, la ligne. Mais ce calme suscite une distance — non celle de l’indifférence, mais celle du manque d’étincelle. Les costumes, pourtant scintillants, ne suffisent pas à combler ce vide subtil.
Wheeldon compose dans un registre formel élégant : trois duos d’intimité encadrés par des ensembles ; les ruptures de rythme et les variations de textures sont là. Musicalement, la partition d’Ezio Bosso, ponctuée d’éclats de Vivaldi, offre un paysage acoustique lumineux. La chorégraphie répond souvent de manière presque littérale aux motifs sonores : canon de pas, suspension quand la musique s’éteint, montée collective comme une vague.
Mais l’enjeu est ailleurs. Quand Wheeldon trouve l’équilibre — pas de deux dépouillés, moments de dialogue humain, respiration entre les gestes — la magie opère. À d’autres moments, le geste paraît trop poli, trop prévisible. Les figures de virtuosité, belles et impeccables, manquent parfois de surprise, de souffle risqué. Après le vertige de Goecke et l’atmosphère haletante de Lidberg, Within the Golden Hour semble plus léger, plus distant.
Un contraste, un contexte et une récompense
Ce contraste — entre l’ouragan intérieur et la clarté maîtrisée — trouve un écho particulier lors de la répétition pré-générale de Wake up !, où Perle Vilette de Callenstein et Simon Asselin ont été récompensés du Prix Clerc Milon de la Danse le 9 octobre 2025. Une distinction significative, surtout dans ce contexte d’exigence, et un signe que la troupe Bordeaux dirigé par Eric Quilleré dispose non seulement d’œuvres fortes, mais d’artistes capables de les porter intensément et parfois de surprendre.
Woke Up Blind reste la pièce la plus urgente de la soirée — celle qui frappe et rappelle que la danse vit de risque et de nécessité. The Shimmering Asphalt offre un rêve pur, suspendu, rare teinte de beauté retenue et de silence en creux. Within the Golden Hour, pièce de grande facture, élégante et riche, demeure le moins profond des trois : non qu’elle manque de grâce, mais parce qu’elle offre moins de risque, moins d’élan dramatique. Dans cette soirée, un rappel précieux : après le choc, après la déflagration de certaines œuvres, la beauté maîtrisée est un confort, mais elle ne captive pas toujours. Le Ballet de Bordeaux montre qu’il est prêt pour les extrêmes, pour l’intensité. On attend la prochaine fois, avec impatience et, osons-le, un soupçon d’exigence accrue.
Cédric Chaory
©Sigrid Colomyes pour vignette à la Une / ©Pierre Planchenault sur page article
Vu le lundi 13 octobre 2025
