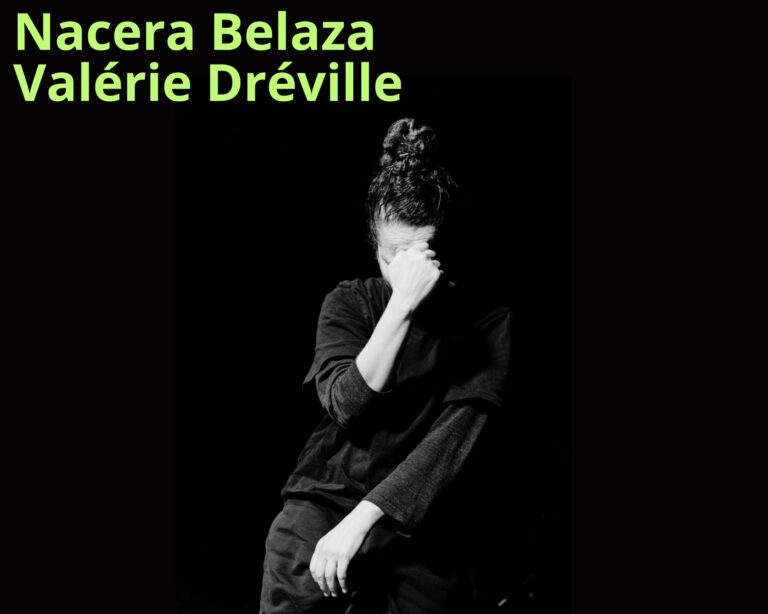
L'écho de leur corps
En résidence de création à Mille Plateaux CCN La Rochelle fin août, Nacera Belaza, accompagnée de la comédienne Valérie Dréville, revient sur L’écho, sa nouvelle création présentée prochainement au Festival d’Automne. Une interview riche où se dessinent sa vision de la danse comme langage, le corps comme résonance de l’imaginaire, l’importance du vertige et de l’inconnu, l’importance de l’expérience vécue par le spectateur tout comme la nécessité d’un langage commun.
Votre rencontre semble avoir été une évidence. Pouvez-vous revenir sur le moment où vous avez senti que ce duo devait exister ?
Nacera Belaza : C’est à l’invitation d’Hortense Archambault, directrice de la MC93 – un lieu de croisement entre le théâtre et la danse – que nous nous sommes rencontrées. Ce lieu a toujours créé des intersections, des frictions. C’est aussi là que beaucoup de gens du théâtre ont découvert mon travail. Je précise d’ailleurs que je me sens souvent plus comprise par les musicien·nes ou les comédien·nes. Comme leur grille de lecture diffère et que leurs attentes vis-à-vis des codes de la danse ne sont pas les mêmes, il me semble que la réception de mon travail en devient plus juste.
Le théâtre m’a toujours intéressée : j’ai été assistante sur plusieurs pièces et j’ai régulièrement travaillé avec des comédien.nes. J’essaie toujours que les danseurs soient soumis aux mêmes règles que les comédiens, c’est-à-dire à l’idée de communiquer, de s’adresser à quelqu’un. Pour moi, l’interprète sur scène est un instrument très sophistiquée, avec des fréquences et des canaux à ouvrir. Je ne le réduis pas à un simple corps physique. On dit parfois que certains interprètes se tournent vers la danse parce qu’ils trouvent dans les mots ou dans la parole une limite, et que le mouvement leur offre une autre manière de s’exprimer. Comme si danser n’était pas parler… Mais je suis sûre d’une chose: dès que j’ai commencé à danser, cela libérait une parole. Je parlais. Ce n’était pas juste un mouvement. C’est devenu de plus en plus évident pour moi que je cherchais un mouvement audible. J’ai beaucoup travaillé sur le rapport du mouvement au silence, à l’interlocuteur, à la musique, la lumière ou encore l’espace. Ma question était : comment se faire entendre quand on na pas accès aux mots ?
Pour revenir à notre rencontre, j’avais vu Valérie plusieurs fois sur scène. Puis Hortense l’a également conviée à découvrir mon travail. Quand je vais voir un spectacle, ma lecture de l’objet scénique me pose ces questions : qu’est-ce qui justifie que ça dure ? quel type d’attention cela crée ? Ce n’est pas tant une question de texte ou d’histoire mais d’écoute activée chez l’interprète et le public… Chez Valérie, il y a un pouvoir d’interprétation très fort. Elle utilise son corps comme une caisse de résonance. Elle a une vraie visualisation de ce qu’elle dit, comme un conteur : sa conscience fait que son corps ne vient jamais contredire ou parasiter ses mots. Au contraire, il amplifie. Son corps se met toujours au diapason de sa parole, il diffuse, il résonne. Et je me suis dit : « elle danse. »
Cela m’a conforté dans ma réflexion : pourquoi avons-nous parfois du mal à retrouver cette densité-là dans le mouvement des danseurs ? Ils développent souvent une puissance visuelle liée au corps physique, à un pouvoir de séduction mais, à mon sens, leur pouvoir d’émission reste faible.
C’est à partir de là que nous avons commencé à mener des ateliers ensemble, pour voir si quelque chose pouvait advenir. Nos plannings nous ont beaucoup contraintes, mais le désir était bien là.
Valérie : le corps comme d’un lieu de parole, d’un réceptacle de l’imaginaire, cela vous parle ?
Valérie Dréville : L’imaginaire est effectivement dans le corps. Tout ce qu’a dit Nacera, je pourrais le reprendre mot pour mot, je n’ai rien à ajouter. Ce que je peux dire, c’est que ça s’est vraiment passé comme ça. J’ai participé à des aventures théâtrales qui demandaient un vrai travail sur soi : prendre conscience de ses limites et chercher comment les dépasser. Et c’est devenu difficile pour moi de ne plus être embarquée dans des histoires de cette intensité-là.
Avec Nacera, je suis servie : là, c’est le maximum. Parce qu’au fond, qu’est-ce qu’un spectacle ? Un simple objet de consommation ou bien autre chose ? Toute la question est là. Et pour l’interprète que je suis, si je n’ai pas, pendant le processus – qu’il dure deux mois ou deux ans – l’expérience d’un véritable voyage, d’un territoire que je ne connaissais pas avant, cela n’a aucun intérêt. Me contenter d’utiliser mon savoir-faire ? Non. Ce qui m’intéresse, c’est précisément d’aller au-delà de ce savoir-faire. C’est pour cela que la rencontre avec Nacera est inespérée. Dans le théâtre, ce type d’approche est très rare, c’est une certitude.
Votre création explore la frontière entre théâtre et danse, entre mots et gestes…
Nacera : Non, elle explore comment rendre audible le mouvement. Cela réconcilie le canal de la parole et celui du corps. C’est tout un projet, et cela me suffit : rendre audible l’imaginaire à travers le corps, comme s’il s’agissait d’une parole. C’est quelque chose que j’atteins très difficilement par la danse seule.
Nous n’avons pas besoin des mots, presque pas de mouvement non plus. C’est autre chose : une zone plus trouble, plus difficile d’accès. Il faut sans doute créer des éléments de langage différents pour en parler. Je suis désolée de le dire mais il est tellement plus simple de résumer en disant : « c’est du théâtre et de la danse ». Alors que ce n’est ni l’un ni l’autre. C’est avant tout une exploration. C’est comme partir vers un territoire inconnu. On ne sait pas ce qu’on va y trouver, ni ce qu’on va y vivre, mais on s’autorise à le vivre. La création n’est pas un produit fini qui doit répondre à une liste de critères. Le public est alors invité à prendre part au voyage avec nous. Il me semble que tant qu’on acculera l’artiste à remplir un cahier des charges pour « satisfaire », les choses évolueront lentement.
Le vertige, l’inconnu, l’instant du basculement reviennent souvent dans vos propos. Comment travaillez-vous à les accueillir dans votre processus de création ?
Nacera : C’est une recherche qui commence par des intuitions, quelques images qui servent de point de départ et aussi à créer de la matière que je suis amenée à sculpter, épurer. Je me rends compte qu’une pièce est vraiment conséquente lorsqu’elle m’oblige à emprunter un chemin que je ne connais pas, qui m’effraie et que je n’ai même aucune garantie que cela aboutisse à une pièce, je sais alors que je suis sur la bonne voie.
Cela fait trente ans que je crée, on peut considérer que je connais les ficelles de la création. Je sais par exemple ; que l’on a longtemps attendu de moi que je refasse Le Cri ou une pièce équivalente. Je peux le comprendre : un choc artistique ou émotionnel, ressenti par le public comme par les professionnels, crée parfois une attente de reproduction. Il devient alors difficile de s’en affranchir. Mais la reproduction ne me satisfait pas. Mon projet n’est pas seulement artistique, il est aussi profondément humain. Je me sers de moi-même pour explorer, pour dépasser des limites. Chaque création est la démonstration que ce en quoi je crois est possible. Bien sûr, cela aboutit à des pièces, mais ce n’est pas ce qui compte le plus.
Il y a parfois un malentendu avec la société du spectacle : bien souvent on attend des formes rassurantes, reproductibles mais heureusement, une grande partie du public comprend et adhère à la nécessité d’une telle démarche. Mes pièces font partie d’un projet plus fragile, plus périlleux surtout dans le contexte actuel. Mais pour moi soit je suis en mesure de prendre ce risque là, parce que j’en ressens toujours la nécessité, soit j’irais cultiver un jardin.
Comment se construit l’écoute entre vous deux dans le studio, entre une comédienne et une chorégraphe ?
Nacera : En toute transparence au début, j’ai été de nombreuses fois déstabilisée. Cette rencontre m’a contrainte a redéfinir mon approche et mes outils mis en place avec les danseurs. Petit à petit, j’ai commencé à exposer les principes de mon travail, et Valérie m’a partagé son expérience théâtrale, les techniques qu’elle avait traversées puis il y a eu un glissement vers mon propre travail.
C’est une autre zone de turbulence, parce que Valérie ne me demande pas de formaliser les mêmes choses. Elle a un parcours d’interprète très exigeant, elle a appris à se connaitre. J’ai donc pu tester beaucoup de choses, et cela a conforté les intuitions de départ. Je ne voyais pas quelle forme cela pouvait prendre, ni comment dialoguer. Mais ce travail a finalement remis en question ma manière de fonctionner avec les danseurs. D’une certaine façon, travailler avec Valérie a recentré mon travail à l’endroit de l’imaginaire. Elle m’a ramenée à ma langue. Nous sommes deux femmes d’un certain âge, mais qui affectionnons plus particulièrement le péril et le fait de se tenir au bord.
Valérie : Alors, comment avons-nous entamé cette collaboration ? C’est forcément Nacera qui l’a impulsée, qui a commencé. Parce que moi, je ne sais rien… ou plutôt, je ne sais pas que je sais. Il faut qu’elle stimule cette réminiscence-là. Le matériau autour duquel, dans lequel, nous travaillons, c’est l’invisible. Donc forcément, c’est difficile : il faut inventer un vocabulaire commun. Elle a le sien, à moi de le comprendre, de le traduire d’une certaine façon.
Parfois, sur certains points, on achoppe. Mais j’ai l’habitude de cette question de la traduction : dans l’école russe, Stanislavski faisait exactement cela, nommer les comportements de l’interprète. C’est passionnant et toujours inconnu. Que veut dire « l’espace », par exemple ? Et pourtant, ce n’est rien, mais ça ouvre un monde.
Avec le temps, nous avons construit une communication, et ce n’est pas terminé : jour après jour, elle se poursuit. J’apprends énormément, comme une débutante. Et ça me plaît. Je le dis souvent tout haut : « je ne sais pas, je ne comprends pas, je n’y arrive pas ». Mais j’apprends à retourner cela, à m’intéresser précisément à ce que je ne sais pas. Je pose des questions au lieu de rester dans le « je ne sais pas ». En fait, j’ouvre cet endroit obscur, opaque. Et soudain, la relation à soi, à son corps, à l’espace change. Et à l’âge que j’ai, j’en ai besoin : sinon tout a tendance à se nécroser. C’est donc un travail sur soi incroyable.
Nacera : Ce travail sur soi, Valérie, tu l’as toujours mené, me semble-t-il, mais ici tu le fais à travers le corps. Or il n’y a pas de connaissance, pas d’expérience plus vraie que ce que nous livre le corps. Avec le mental, on a souvent l’illusion de comprendre, mais l’expérience du corps nous informe de manière plus juste et plus profonde.
J’avais le sentiment qu’il fallait opérer une sorte de transfert de ton expérience théâtrale vers ce nouvel instrument, ce nouveau canal de dialogue avec le public. Cela n’a pas été simple : nous continuons d’avancer avec beaucoup de précaution. Nous nous déstabilisons mutuellement, et cela peut être inconfortable, mais il est important d’en passer par là. Pour moi, un des critères qui définit à mes yeux un interprète, c’est sa capacité à utiliser son intime dans un cadre artistique et professionnel.
Valérie : Oui ce que nous faisons est bel et bien du travail. Et ce n’est pas évident, parce que tout se mélange : nous sommes nos propres instruments – c’est nous, c’est notre corps, et en même temps c’est le travail de création. Une sorte de grande confiture. Je crois que c’est avant tout un rapport au travail : on parle de quelque chose qui existe entre nous.
Et cette sortie de résidence à La Manufacture CDCN La Rochelle, que va y découvrir le public ?
Nacera : Que vous dire ? Le travail de studio peut durer des années, mais il nous faut passer l’épreuve du public. Je constate une chose : si nous ne sommes pas vigilantes, la pièce que nous travaillons en studio ne sera pas la même que celle que le public va éprouver. C’est une autre partie de l’expérience.
Je crée une pièce, je la vois, elle existe, mais elle m’échappe encore. Et c’est en présence du public que je vais vraiment l’entendre – du point de vue du chorégraphe comme de celui de l’interprète. C’est un peu comme apprendre une langue : on ne sait pas toujours comment elle communique avec l’autre jusqu’à ce que quelqu’un l’entende et que l’on se dise : « Ah oui, c’est cette langue-là ! » La part manquante de la pièce se révèle donc en même temps que le public. Sa présence active est essentielle.
Hâte donc de montrer ce work in progress de L’écho au public ?!!
Nacera : Il est important que le public vive une expérience. Il ne faut pas tout baliser pour lui. Il doit rester libre pour y accéder complètement. Expliquer avant, c’est créer des attentes. Cela signifie que le spectacle ne peut plus vraiment avoir lieu, parce qu’il fait déjà l’objet de projections et trop souvent, la rencontre ne se produit pas précisément à cause de cela : le public arrive avec des images préfabriquées, il n’est pas disponible pour une autre expérience.
Bien sûr, il y a des metteurs en scène et des chorégraphes qui choisissent de répondre à la question du menu : « Vous allez voir ça, puis ça, et enfin ça ». Moi, je rêve d’une communication sur la danse qui soit plus ambitieuse. Décrire une pièce ne donne jamais réellement envie. Décrire, c’est même un reflet déformé de la pièce. Combien de films n’aurais-je jamais découverts si je m’étais contentée de lire leur descriptif. Alors comment transmettre l’inconnu éprouvé pendant la représentation, l’expérience elle-même ?
Valérie : J’aime l’expérience de la représentation. C’est là que se dit l’essentiel pendant la présentation. Pour le théâtre, en tout cas, c’est vrai ; pour la danse, je ne sais pas encore.
Après, le retour du public, par exemple au bord du plateau, ne me satisfait pas toujours. Je le trouve souvent en deçà de l’expérience elle-même, de ce qui s’est passé dans le silence. Le public n’ose pas parler de ce qu’il a ressenti, ou alors il n’y a pas encore accès : il faut laisser reposer, décanter, rêver. Les questions posées sont souvent superficielles, et cela nous ramène tous un peu en arrière.
Nacera : Concernant notre travail actuel : il n’y a pas de texte, il y a donc peu de prises. Je pense que les retours vont être intéressants. J’ai déjà eu des retours passionnants sur certaines de mes pièces, et les rencontres avec le public ont été étonnantes. Cela nous renseigne sur ce à quoi nous sommes sensibles au fond. Dans ces moments-là, je me dis : « Tu ne fais pas fausse route. » Ces échanges peuvent être très riches et agréables à entendre. Bien souvent, ce ne sont pas tant les questions sur la pièce ou sur la démarche qui se révèlent les plus intéressantes, mais plutôt la parole du public, lorsqu’il ose partager son expérience la plus intime de la représentation
Propos recueillis par Cédric Chaory
©Edouard Jacquinet
L’écho : création à la MC93 du du 26 septembre au 11 octobre 2025 puis tournée.
