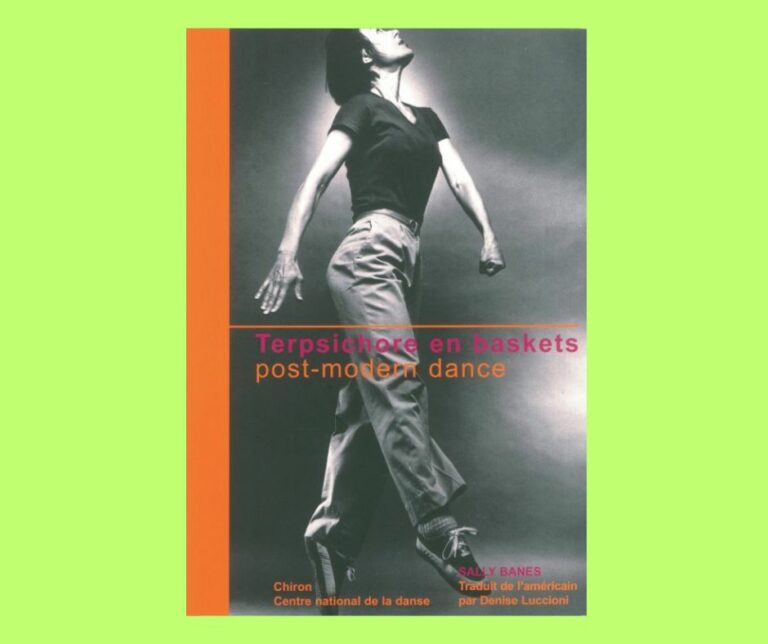
Terpsichore en baskets : la révolution au bout des pieds
Publié en 1979 et revu en 1987, Terpsichore en baskets de Sally Banes est à la fois chronique et étude critique de la danse post-moderne américaine. La critique américaine y déplie l’histoire d’un basculement majeur : la danse contemporaine qui, dans les années 1960, quitte ses habits dramatiques pour se repenser de l’intérieur, baskets aux pieds, sur les planchers bruts des églises et des lofts new-yorkais. Au-delà de la description exaltante d’une période relativement récente, ce document offre une remontée aux sources de pratiques revisitées par la danse française actuelle, en témoignant d’une extraordinaire liberté d’inventer, en prise directe sur la dimension politique de l’art en général.
Modern dance : un modernisme inachevé
Aux origines, la modern dance s’impose au début du XXᵉ siècle avec Loie Fuller, Isadora Duncan, Ruth Saint Denis et Ted Shawn. Dans les années 1920, une nouvelle génération – Martha Graham, Doris Humphrey, Charles Weidman – rompt avec l’esthétique décorative de Denishawn. Graham puise dans le cycle naturel de la respiration pour développer son fameux contraction/release, insérant thèmes contemporains et inspiration nationale dans un espace théâtral abstrait. Humphrey, elle, fonde sa grammaire sur les contrastes de rythme et de dynamique, et sur la mise en danger kinesthésique de la chute et du rétablissement, métaphore de la vie sociale.
La modern dance se caractérise par le poids, la dissonance, une horizontalité puissante, des structures lisibles (thème, variation, retour), et une stylisation du mouvement. Elle s’entoure de musique, costumes, éclairages et accessoires pour exprimer émotion et message social. Mais, pour Banes, elle n’a jamais été totalement moderniste : contrairement à d’autres arts, elle n’a pas pleinement inventé les propriétés de son médium ni dissocié ses éléments formels de tout contenu extérieur.
1960-1973 : la dissidence post-moderne
C’est là qu’intervient la génération Judson. Autour de Robert Dunn – formé chez Merce Cunningham – un atelier de composition débouche sur le premier concert à la Judson Memorial Church, le 6 juillet 1963. Simone Forti, Steve Paxton, Yvonne Rainer, Deborah Hay y proposent une rupture nette.
Ici, pas de mouvement choisi pour « faire joli » : il résulte de décisions, de plans, de schémas, de règles. Les critères visuels traditionnels volent en éclats. La musicalité, le personnage, l’humeur, l’ambiance sont rejetés, surtout dans la post-modern dance analytique. L’exploration porte sur l’espace, le temps, le corps, comme autant d’hypothèses sur la nature de la danse.
Susan Sontag – dont l’essai Against Interpretation (1962-65) devient une bible – inspire cette orientation : il ne s’agit pas de signifier mais d’éclairer et d’ouvrir l’expérience.
De la purge à l’abstraction
De 1968 à 1973, trois nouveaux thèmes apparaissent : la politique, la participation du public, et les influences non-occidentales (souvent via Carl Jung). Puis, dans les années 1970, la post-modern dance analytique pousse l’épuration à l’extrême : silence, répétition, inversion, systèmes mathématiques, formes géométriques, comparaisons et oppositions. Le mouvement devient un objectif en soi, et la structure prend le pas sur lui (Trio A d’Yvonne Rainer en est l’icône). L’attention au corps frôle la précision scientifique.
1978-1980 : le retour du sens
À force d’avoir élagué tout contenu, la danse analytique donne l’impression de n’en avoir plus aucun. Dès 1978, un tournant s’amorce : réintroduire l’expression, la narration, l’autobiographie, de nouveaux liens avec la musique. Glacial Decoy (Trisha Brown) et Dance (Lucinda Childs) marquent ce retour.
De 1979 à 1980, une nouvelle génération surgit dans un monde jugé de plus en plus hostile. C’est « le retour du refoulé » : recherche de sens, engouement critique pour le structuralisme et le post-structuralisme. La chorégraphie s’ouvre de nouveau à des contenus extérieurs au matériau chorégraphique, appropriant des systèmes fonctionnels comme un langage. Narration, signes, structures verbales et gestuelles se mêlent.
Dix chorégraphes, mille postures
L’auteure Sally Banes choisit de présenter dix chorégraphes qui incarnent toutes les postures théoriques et pratiques de l’esthétique post-moderne, du minimalisme corporel de Lucinda Childs à l’endurance de Douglas Dunn, du nouvel expressionnisme de Meredith Monk aux distanciations narratives de Kenneth King (Simone Forti, Yvonne Rainer, Steve Paxton, Trisha Brown, David Gordon, Deborah Hay, Meredith Monk, Lucinda Childs, Kenneth King, Douglas Dunn). Par ailleurs, Sally Banes mentionne également le Grand Union, collectif d’improvisation de danseurs-chorégraphes post-modernes actif à New York entre 1970 et 1976, considéré comme l’une des expériences les plus radicales et libres issues de la Judson Dance Theater.
Un livre-miroir
Terpsichore en baskets n’est pas seulement une étude historique : c’est le miroir d’une époque où la danse, en se déshabillant de ses oripeaux dramatiques, affronte ses propres limites. Elle passe de la densité émotionnelle de la modern dance à l’ascèse analytique, avant de retrouver la chair de la narration. Une histoire en boucle, où chaque génération défait et reconstruit la précédente, toujours avec cette conviction : un pas, même dépouillé, peut encore changer la donne.
Soixante ans plus tard, l’onde de choc post modern dance n’a pas cessé de se propager. Sur les scènes contemporaines, de Paris à Montréal, les héritiers continuent de flirter avec le quotidien. La marche devient partition, l’essoufflement une bande-son. Anne Teresa De Keersmaeker tisse ses chorégraphies comme des grilles mathématiques ; Boris Charmatz repeuple les musées de danseurs en baskets ; Mickaël Phelippeau met amateurs et professionnels sur le même plateau.
Autre legs : la curiosité tous azimuts. Les post-moderns dialoguaient avec les arts visuels, la poésie, la musique expérimentale. Aujourd’hui, les chorégraphes branchent leurs corps sur des installations vidéo, investissent friches industrielles et places publiques, flirtent avec la performance art.
L’héritage est aussi politique. Déhiérarchiser les corps, abolir la frontière entre scène et vie, c’est résister à l’uniformité. C’est affirmer que l’art peut surgir n’importe où, avec n’importe qui. Dans les pas de ces irrévérencieux de Judson, la danse contemporaine trace encore ses chemins de traverse, là où personne ne l’attend.
Cédric Chaory.
Terpsichore en baskets, post-modern dance | Centre national de la danse
